
Prix Nobel Economique 2025: notre analyse
Le focus sur la croissance économique a-t-elle limité les perceptions du développement ? Une discussion sur les lauréats du Prix Nobel 2025
Cette semaine, l’Académie royale suédoise a annoncé les lauréats du Prix Nobel d’économie. La récompense a été partagée entre Joel Mokyr, Philippe Aghion et Peter Howitt, qui se sont concentrés sur la relation entre l’innovation et la croissance économique.
Cependant, le Prix Nobel d’économie est souvent sujet à controverse. Non seulement il tend à favoriser les institutions et recherches centrées sur l’Occident, mais il récompense également généralement des idées qui restent dans le cadre de l’économie néoclassique. Parmi celles-ci, la question de la croissance soutenue est devenue de plus en plus pertinente dans le domaine, étant donné qu’elle est apparue exclusivement au cours des 200 dernières années de l’histoire humaine (Our World in Data, 2018).
Dans un scénario mondial marqué par les inégalités de revenus, la crise climatique et des paysages politiques fragmentés, il est courant de se demander si ces modèles économiques très célébrés offrent des réponses pragmatiques, et surtout dans quelle mesure ils sont pertinents pour les économies émergentes. La croissance économique par l’innovation reste-t-elle la question clé à laquelle les politiques doivent répondre ? Ou bien a-t-elle éclipsé d’autres enjeux fondamentaux du développement, façonnant un discours limité sur la politique économique ?
Innovation, compétition et croissance – un aperçu du travail des lauréats
Joel Mokyr, historien économique, a axé ses recherches sur l’identification des conditions permettant de soutenir la croissance par le progrès technologique. En observant la Grande-Bretagne pendant la Révolution industrielle, l’auteur a cherché à expliquer cette croissance économique sans précédent et durable. Mokyr illustre que la principale différence est qu’après la Révolution industrielle, les sociétés ont commencé à valoriser la compréhension du pourquoi des choses, et non plus seulement du comment, ce qui a permis une innovation continue en s’appuyant sur les connaissances existantes. Par conséquent, les sociétés ont adopté une culture épistémique où la connaissance scientifique joue un rôle central dans l’économie.
Dans le même ordre d’idées, Aghion et Howitt ont développé un modèle économique démontrant que la croissance résulte de la « destruction créatrice », un terme initialement développé par Joseph Schumpeter. Autrement dit, les entreprises qui introduisent des innovations sur le marché surpassent celles qui ne le font pas, éliminant ainsi les produits obsolètes au profit de produits améliorés. Le modèle considère également l’usage des brevets pour générer des profits économiques, qui servent d’incitations à l’investissement continu dans l’innovation. Par conséquent, les auteurs insistent sur l’importance de politiques qui encouragent et protègent l’innovation afin de soutenir une croissance à long terme.
Le travail de ces lauréats du Nobel ne représente qu’une partie de la recherche centrée sur la stimulation de la croissance par l’innovation technologique. Ces arguments ont une implication importante pour le développement et l’analyse des politiques publiques, où les gouvernements peuvent concevoir leurs budgets autour de ces objectifs. Par exemple, le modèle d’Aghion et Howitt peut aider à concevoir des instruments politiques tels que les subventions qui rapprochent, en principe, l’investissement dans l’innovation de l’optimum social (La Fondation Nobel, 2025).
Une focalisation sur la croissance a-t-elle conduit à une vision limitée du développement ?
Si l’on suppose que l’objectif de la croissance est d’améliorer les conditions de vie des populations à travers le monde, et que le moyen d’y parvenir est le progrès technologique, on peut alors identifier certaines limites à cette approche. Les gains économiques peuvent ne pas conduire au résultat escompté si les méthodes employées négligent des contraintes essentielles. Si l’on considère les Objectifs de développement durable des Nations Unies, la croissance économique n’en est qu’un parmi plusieurs.
À l’heure de la crise climatique, ignorer les externalités négatives de la technologie, notamment sur l’environnement, serait une erreur grave. Le besoin croissant en ressources naturelles pour développer ou maintenir ces innovations peut entraîner pollution et pratiques d’extraction non durables (Mohan, 2025). De plus, le contexte dans lequel ces ressources sont exploitées est souvent caractérisé par des conditions violant les droits humains. Ces externalités prennent un poids plus important lorsqu’on considère la répartition inégale du travail, et donc du fardeau, entre le Nord et le Sud global.
Un exemple clé est l’industrie du cobalt en République démocratique du Congo, où des travailleurs « indépendants » sont exposés à des conditions de travail dangereuses pour quelques dollars par jour seulement (Gross, 2023). De même, des communautés sud-américaines vivent actuellement une « ruée vers l’or blanc », l’augmentation de la demande de lithium leur offrant des opportunités d’exploitation. Le manque d’institutions stables, de politiques orientées et les pratiques minières non durables pourraient condamner la région à la « malédiction des ressources », où les pays riches en ressources naturelles présentent souvent des niveaux élevés de pauvreté et d’inégalités (Singh, 2024). Ces deux minerais sont essentiels au développement des nouvelles technologies, en particulier celles visant à remplacer les combustibles fossiles. Alors que l’innovation peut conduire à la croissance économique par le développement de nouveaux biens et l’exploitation des ressources, une exploitation irresponsable pour répondre à la demande croissante peut avoir des conséquences négatives sur le bien-être social et environnemental.
En outre, ces inégalités dans la répartition des charges entre le Nord et le Sud global peuvent aussi impliquer une distribution inégale des rentes économiques liées à l’innovation. Par conséquent, bien que l’innovation puisse être bénéfique, les gains peuvent être biaisés. L’inégalité n’est ainsi pas seulement affectée entre pays, mais aussi à l’intérieur d’eux. Un working paper du National Bureau of Economic Research suggère que les entreprises concentrent une grande partie du surplus des nouveaux brevets, et que les bénéfices sont majoritairement concentrés parmi les travailleurs à hauts revenus et les investisseurs (Kline et al., 2018). Ainsi, bien que la croissance économique soit réalisée par l’innovation, les profits ne se diffusent pas forcément de manière équitable dans le reste de la société. De même, un working paper de l’UCL souligne le rôle des institutions modernes dans la persistance des concentrations de rentes (Mazzucato et al., 2020). De ce fait, la question de la croissance par l’innovation est insuffisante si les politiques ne tiennent pas compte de la possibilité d’une répartition inégale des bénéfices, ce qui peut contribuer à accroître les inégalités de revenus.
Enfin, ce dernier point met en lumière le rôle des institutions dans la facilitation de l’innovation et, par conséquent, de la croissance. L’attention portée par Mokyr à l’ouverture d’une société au changement peut négliger la relation entre l’évolution des institutions et la culture (Hodgson, 2021). Reprenant les travaux des lauréats du Nobel de l’an dernier, l’innovation peut être fortement liée à la nature des institutions : distribuent-elles de manière égale la connaissance, les ressources et le pouvoir nécessaires pour favoriser l’innovation ? (Acemoğlu & Robinson, 2012). Il est donc aussi nécessaire de prendre en compte la réalité structurelle des économies dans la recherche de la croissance et de considérer l’héritage historique ayant conduit à leur émergence (par exemple, la colonisation).
Conclusion : fausses dichotomies dans la pensée économique et l’élaboration des politiques
Discréditer totalement la croissance économique en tant qu’aspect pertinent du développement pourrait également être préjudiciable. Des niveaux plus élevés de PIB, une mesure du développement économique, sont fortement corrélés à une meilleure qualité de vie et à des standards de vie supérieurs.
Cependant, étudier la croissance portée par l’innovation de manière isolée peut être aussi inefficace que de ne pas le faire du tout. Critiquer les approches centrées sur la croissance dans le développement permet de mettre en lumière des limites importantes de notre approche. Prendre en compte le rôle des externalités, des inégalités, des institutions et des héritages structurels est essentiel pour développer des politiques visant à conjuguer croissance économique, égalité et un niveau de vie sécurisé.
Globalement, les politiques économiques et les théories doivent être abordées avec nuance et ne devraient pas être traitées comme des idées isolées. Le Prix Nobel de cette année n’est qu’une pièce d’un puzzle plus vaste dans l’effort pour atteindre un développement durable et une égalité mondiale. La croissance peut être positive mais limitée dans son ampleur et son impact. Surtout, les approches uniformes doivent continuer d’être questionnées, même si elles sont très respectées dans le domaine. Des théories et modèles complémentaires peuvent contribuer à surmonter ces limites, en particulier ceux qui centrent les perspectives, expériences et contextes négligés du Sud global.
Au lieu de se demander s’il faut concentrer les politiques sur un aspect particulier du développement plutôt qu’un autre, il est peut-être temps de commencer à évaluer comment tous ces aspects sont interconnectés. Peut-on concevoir des politiques holistiques pour assurer croissance et bien-être dans le Sud global si nos recherches restent focalisées sur le Nord global comme référence ?
Références:
Hodgson, Geoffrey M. “Culture and Institutions: A Review of Joel Mokyr’s A Culture of Growth.” Journal of Institutional Economics 18.1 (2022): 159–168. Web.
Kara, Siddharth. “Red Cobalt in Congo’s DRC Mining.” NPR, 1 Feb. 2023, www.npr.org/sections/goatsandsoda/2023/02/01/1152893248/red-cobalt-congo-drc-mining-siddharth-kara.
Mazzucato, M., Ryan-Collins, J. and Gouzoulis, G. (2020). Theorising and Mapping Modern Economic Rents. UCL Institute for Innovation and Public Purpose, Working Paper Series (IIPP WP 2020-13).
Mohan, Deepanshu. “Nobel Award: Celebrate Creative Destruction but Spare a Thought for Its Impact beyond GDP Growth.” Mint, 17 Oct. 2025, 01:00 pm IST, www.livemint.com/opinion/online-views/nobel-prize-2025-economics-joel-mokyr-philippe-aghion-peter-howitt-creative-destruction-industrial-policy-india-factory-11760676068822.html.
Patrick Kline, Neviana Petkova, Heidi Williams, and Owen Zidar, « Who Profits from Patents? Rent-Sharing at Innovative Firms, » NBER Working Paper 25245 (2018), https://doi.org/10.3386/w25245.
Philippe Aghion and Peter Howitt, « A Model of Growth Through Creative Destruction, » NBER Working Paper 3223 (1990), https://doi.org/10.3386/w3223.
Prize in Economic Sciences 2025 – Popular Information.” NobelPrize.org, The Nobel Foundation, 2025, www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2025/popular-information/.
Singh, Jewellord Nem. “How Latin America Can Harness the White Gold Rush.” The World Today, Feb. 2024, Chatham House, 2 Feb. 2024, updated 21 Mar. 2024, www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2024-02/how-latin-america-can-harness-white-gold-rush
Unit 1 ‘The capitalist revolution’ Section 1.3 ‘History’s Hockey Stick: Growth in income’ in The CORE Team, The Economy. Available at: https://tinyco.re/28126370 [Figure 1.1b]



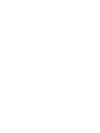
Laisser un commentaire