
Hukou : comment la Chine contrôle sa migration interne
En discussion avec Dr Charlotte Goodburn, directrice adjointe du Lau China Institute et maître de conférences en politique chinoise au King’s College de Londres
Établi en 1958, le hukou, système d’enregistrement des ménages chinois, attribuait à chaque citoyen un statut rural (agricole) ou urbain (non agricole) (Fu & Ren, 2010). Bien que cette distinction ait été officiellement abolie en 2014, le lieu d’enregistrement continue de déterminer l’accès aux prestations publiques, conditionnant ainsi les droits sociaux et les services auxquels les citoyens peuvent prétendre. À l’origine, le hukou visait à freiner l’exode rural vers les villes afin de maintenir les prix des denrées agricoles à un niveau bas, soutenant ainsi le processus d’industrialisation du pays.
À la suite des réformes économiques des années 1980, de vastes mouvements migratoires ont accompagné l’expansion rapide des mégapoles chinoises. Entre 1980 et 2010, la population urbaine est passée d’un cinquième à plus de la moitié de la population totale (Pizzi & Hu, 2022). Depuis la fin des années 1990, de nombreuses petites villes ont entrepris de réformer le système pour faciliter l’obtention du hukou local et encourager leur croissance démographique. À l’inverse, les grandes métropoles cherchent à maîtriser leur expansion en imposant des critères d’accès toujours plus stricts.
Charlotte Goodburn, directrice adjointe du Lau China Institute et maîtresse de conférences en politique chinoise au King’s College de Londres, met en lumière les dynamiques actuelles du hukou et son influence sur l’identité des migrants internes. Son analyse souligne la complexité du contrôle des mobilités en Chine, malgré la persistance de dispositifs dissuasifs tels que le système du hukou.
Aujourd’hui, comment le système du hukou façonne-t-il les schémas de migration interne ?
La première tendance importante, observée depuis 2014, est une libéralisation accrue à la base et un renforcement des restrictions au sommet. En pratique, cela signifie que de nombreuses petites et moyennes villes ont assoupli les règles d’installation : les travailleurs migrants peuvent s’y établir plus facilement et obtenir un hukou grâce à des systèmes de points de résidence, de permis ou de quotas, avec des exigences plus faibles en matière d’emploi ou d’éducation.
En revanche, les mégapoles et les grandes capitales provinciales ont durci leurs critères, en imposant des conditions liées au niveau d’études, aux compétences, à l’âge ou à la richesse personnelle.
Ainsi, on observe une redirection des flux migratoires : au lieu de se diriger vers les grandes métropoles de premier rang, les migrants s’orientent davantage vers des clusters urbains et des villes de comté, entraînant une migration intraprovinciale plutôt que interprovinciale.
Qu’en est-il de la seconde tendance observée ?
En parallèle, la Chine a observé un passage sélectif d’une migration circulaire (temporaire) vers une migration familiale de plus long terme – mais seulement pour certaines familles et certaines villes. Les barrières liées à l’absence de hukou local (accès à la scolarisation, au logement à bas coût, etc.) poussent encore une partie des travailleurs à adopter des stratégies de migration alternée ou de foyers éclatés, où les parents migrent mais laissent enfants et aînés au village.
Cependant, dans les petites villes où les services de base ont été dissociés du hukou, on observe plus de cohabitation familiale, une durée de séjour plus longue et une volonté de s’installer durablement. Dans les mégapoles, ce changement n’a pas eu lieu : seuls les migrants les plus riches, les plus instruits et les plus “désirables” peuvent y installer leur famille et s’y établir.
Dans l’ensemble, le hukou ne bloque pas la migration, mais il classe les migrants : il permet aux villes d’être très sélectives sur les profils qu’elles souhaitent accueillir, selon les compétences, l’âge ou encore le niveau de richesse. Il détermine qui s’installe où, et à quelles conditions, plutôt que d’empêcher la migration purement et simplement.
Le hukou est-il bénéfique pour les villes chinoises ?
Non, pas toujours. La Chine est un pays très décentralisé fiscalement, avec peu de mécanismes redistributifs entre le centre et les localités. Ainsi, les villes craignent les coûts futurs liés à l’accueil de migrants, même si ces derniers leur rapportent actuellement des revenus. Les mécanismes de portabilité des droits restent faibles, et une grande partie des recettes fiscales va au gouvernement central, sans redistribution adéquate en fonction des migrations.
De plus, les fonctionnaires chinois sont évalués selon le “système d’évaluation des cadres”, basé sur la qualité des services fournis à la population locale enregistrée. Ils ne sont pas évalués sur leur capacité à intégrer les migrants sans hukou. Cela les pousse à concentrer leurs efforts sur les résidents officiellement enregistrés, afin d’obtenir de meilleures notes et promotions.
Le hukou a-t-il été un succès ?
Tout dépend de ce que l’on entend par « succès ».
Le hukou n’a pas été créé à l’origine pour restreindre la migration, mais pour surveiller la population, organiser la distribution des rations alimentaires, et assurer une main-d’œuvre rurale suffisante pour soutenir l’industrialisation. À cet égard, il a été extrêmement efficace.
En matière de migration, il a permis d’éviter la formation de grands bidonvilles durant la première phase d’industrialisation. Mais après 1978, la situation s’est complexifiée : le système a engendré une citoyenneté à deux vitesses dans les villes, avec un marché du travail segmenté et des inégalités d’accès à l’éducation, aux soins et au logement, ainsi qu’un impact intergénérationnel sur les enfants et les personnes âgées restées en milieu rural.
Quelles réformes seraient nécessaires pour rendre le hukou plus efficace ?
Le premier et le plus important défi consiste à assurer une dissociation complète et effective des services publics de base du statut de hukou. La Chine a besoin d’un système dans lequel l’éducation obligatoire universelle et la couverture des soins de santé primaires dépendent du lieu de résidence et non du lieu d’enregistrement.
Deuxièmement, il est nécessaire de garantir une véritable portabilité : lorsqu’un citoyen acquiert des prestations sociales, des aides ou des paiements d’assurance sociale pour la retraite dans une région, il doit pouvoir transférer facilement ces droits vers son nouveau lieu de résidence.
Troisièmement, il faut réformer le système de financement intergouvernemental, afin d’aligner les ressources allouées par le centre sur les obligations des villes d’assurer des services aux nouveaux arrivants. Les recettes fiscales perçues devraient être redistribuées proportionnellement aux besoins réels des villes, ce qui serait toutefois un processus complexe à mettre en œuvre.
Quatrièmement, la Chine doit instaurer un ensemble de critères d’installation transparents et non exclusifs pour permettre aux migrants de s’établir dans les grandes villes. Si l’on compare avec la migration internationale, où existent des politiques claires d’installation et de regroupement familial, rien de tel n’existe vraiment dans le contexte du hukou. Le système a donc besoin de ce type de dispositifs.
Enfin, une réforme de la politique foncière et du logement est également nécessaire afin d’accroître l’offre de logements décents, abordables et accessibles à la location ou à l’achat. Cela permettrait d’éviter l’exclusion des migrants pour des raisons de coût, tout en prenant en compte la question des terres rurales.
Actuellement, la possession d’un hukou local dans un village rural donne droit à la propriété foncière dans ce village. Pour beaucoup de migrants s’installant en ville, perdre cette terre représenterait la perte d’un filet de sécurité essentiel : ils souhaiteraient un hukou urbain, mais ne veulent pas renoncer à leur terre rurale. Il sera donc nécessaire, à terme, de dissocier le statut de hukou de la propriété foncière rurale. Ce sera un processus long et difficile, mais inévitable.
Quel est l’impact du hukou sur l’identité des migrants internes ?
Les migrants deviennent des citoyens de seconde zone dans les villes. Cela modifie leur identité civique, y compris pour les enfants nés en ville mais enregistrés au village. Ils n’ont pas un accès égal aux ressources, ce qui a des effets profonds.
Mais ce phénomène n’est pas propre à la Chine : l’Inde, par exemple, connaît des exclusions similaires sans système de hukou. Les grandes villes indiennes utilisent d’autres mécanismes, comme l’adresse enregistrée sur la carte d’identité Aadhaar, pour limiter l’accès des migrants aux services. Cela montre que le hukou n’est qu’un outil, et non la cause des inégalités : la cause principale réside dans la volonté des grandes villes d’exclure les migrants jugés “indésirables”.
Peut-on vraiment empêcher la migration ?
Non, la migration ne peut pas être arrêtée. Même dans les années 1950-1970, à l’époque la plus stricte du hukou, les gens continuaient à se déplacer. Les écarts économiques et les opportunités demeurent des facteurs puissants d’attraction.
Les migrants adaptent leurs stratégies – migration temporaire, circulation, travail saisonnier – et les villes ont besoin de cette main-d’œuvre. Ce qu’elles cherchent à éviter, c’est la stabilisation durable des migrants qui pourrait générer des coûts sociaux.
En fin de compte, comme le souligne Charlotte Goodburn, la migration ne peut être empêchée, malgré les systèmes dissuasifs tels que le hukou. Le système a pour effet de créer une citoyenneté de seconde zone pour les migrants internes, limitant fortement leur accès aux droits sociaux et aux services publics.
References
Fu, Q., & Ren, Q. (2010). Educational Inequality under China’s Rural–Urban Divide: The Hukou System and Return to Education. Environment and Planning. A, 42(3), 592–610. https://doi.org/10.1068/a42101
Pizzi, E., & Hu, Y. (2022). Does Governmental Policy Shape Migration Decisions? The Case of China’s Hukou System. Modern China, 48(5), 1050–1079. https://doi.org/10.1177/00977004221087426
Contributeurs
Dr. Charlotte Goodburn is the Deputy Director of the Lau China Institute and a Reader in Chinese Politics at King’s College London. To learn more about her research on the Hukou System:
Residence_permits_and_points_systems_Dong_and_Goodburn_2019_JCC.pdf



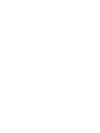
Laisser un commentaire