
Juncao : au cœur de la croissance verte et de la résilience dans le Sud global
Face à l’insécurité alimentaire persistante dans le Sud global, de plus en plus aggravée par le changement climatique, la recherche de solutions agricoles évolutives, durables et adaptables localement est cruciale. Une réponse prometteuse est le Juncao, une agri‑technologie innovante développée par le professeur Lin Zhanxi de l’Université d’Agriculture et de Sylviculture du Fujian. Alliant science biologique et développement local, le Juncao utilise des herbes herbacées à croissance rapide pour cultiver des champignons comestibles et médicinaux, nourrir le bétail, générer de l’énergie renouvelable et restaurer des paysages dégradés. Ce qui rend le Juncao particulièrement séduisant, c’est sa polyvalence et son accessibilité : il nécessite un investissement en capital minimal, s’appuie sur des espèces végétales locales, et peut être adapté à des contextes écologiques et socio‑économiques variés. Soutenu par les Centres de démonstration de technologies agricoles de la Chine, des initiatives du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UNDESA), et des réseaux de coopération Sud‑Sud, le Juncao est de plus en plus reconnu comme un outil puissant pour progresser vers plusieurs Objectifs de développement durable, de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté à la résilience climatique et l’autonomisation économique.
Qu’est‑ce que la technologie Juncao ?
Juncao est un hybride de « jun » (champignon) et « cao » (herbe). Conçue à l’origine pour remplacer les substrats de culture de champignons à base de bois, la technologie Juncao utilise des herbes sélectionnées qui croissent abondamment dans les conditions tropicales et subtropicales. Ces herbes — telles que Pennisetum giganteum et Dicranopteris dichotoma — sont désormais utilisées non seulement pour la production de champignons, mais aussi comme fourrage à haute teneur en protéines pour le bétail, matière première pour panneaux de fibres et papier, et comme matière première pour la biomasse énergétique (FAFU, 2024). Jusqu’à présent, plus de 56 espèces de champignons ont été cultivées avec succès sur des herbes Juncao. En remplaçant le bois dur par des herbes renouvelables, la technologie vise à aider à réduire la déforestation et les émissions de carbone tout en offrant une approche intégrée d’une agriculture efficiente en ressources.
Importante est la capacité des herbes Juncao à pousser dans des sols marginaux, des sites d’enfouissement, des terres inondables dégradées, et même des régions désertifiées. De plus, leurs systèmes racinaires profonds améliorent la stabilité du sol, augmentent la teneur en matière organique (humus), et facilitent la restauration des fonctions écologiques. De cette façon, le Juncao dépasse ses origines simplement agronomiques, agissant comme un levier à la fois économique et écologique pour un changement durable.
Impact agricole, sécurité alimentaire et applications énergétiques
L’analyse empirique confirme le potentiel des interventions liées au Juncao pour améliorer la productivité agricole. Une étude de 2024, modélisant les performances des ATDC (Agricultural Technology Demonstration Centres) de la Chine dans 14 pays africains, a observé des augmentations significatives tant de la surface cultivée (+ 24,11 %) que du rendement des cultures (+ 17,23 %) pour les cultures de démonstration, incluant le riz, le maïs et le sorgho, comparé aux cultures non‑démo (Lin et Cui, 2024). Cela suggère qu’un soutien ciblé via les ATDC, dont beaucoup comprennent des cultures de champignons Juncao, peut stimuler la production locale et renforcer la sécurité alimentaire domestique.
Cependant, l’utilité des herbes Juncao s’étend bien au-delà des champignons. Leur composition nutritionnelle, riche en protéines brutes et en oligo‑éléments, en fait un excellent aliment pour le bétail. Des essais menés en Chine ont démontré que l’ensilage de Juncao offrait des résultats comparables au maïs dans des essais de prise de poids pour le bétail. De même, une étude de 2023 aux Fidji a constaté que l’herbe Juncao, utilisée comme ensilage, soutenait la croissance animale tout en aidant à atténuer les pénuries saisonnières de fourrage. Dans un test, un hectare a produit jusqu’à 450 tonnes de fourrage vert par an, allégeant significativement la pression sur les systèmes de pâturage (PAM, 2023 ; Kavish Krishneel et Jovilisi Tabuyaqona, UNDESA, 2024).
De plus, le potentiel de production d’énergie renouvelable à partir de la biomasse de Juncao est important. Un hectare d’herbe géante Juncao peut produire une bioénergie équivalente à environ 60 tonnes de charbon brut ou 74 000 mètres cubes de biogaz par an. Cela positionne le Juncao comme une matière première prometteuse pour des solutions énergétiques décentralisées, particulièrement dans les zones rurales dépourvues d’un accès fiable à l’électricité (Lin, UNDESA, 2024).
Restauration environnementale et résilience climatique
Les bénéfices écologiques du Juncao sont tout aussi convaincants. En Mongolie intérieure, des dunes de sable désertifiées ont été réhabilitées avec des herbes Juncao, ce qui a entraîné une augmentation de la richesse en insectes et en espèces végétales de plus de 180 %. Ce rebond de biodiversité soutient des services écosystémiques tels que la pollinisation et le cycle des nutriments. Au Rwanda, la plantation en courbes de niveau de Juncao sur les versants a réduit l’érosion des sols de 98,9 % et le ruissellement des eaux de 91,9 %, grâce à ses systèmes racinaires profonds, démontrant son efficacité pour la gestion intégrée des bassins versants. La séquestration du carbone est un autre avantage notable. Remplacer le bois par du Juncao pour les substrats de culture de champignons permet de conserver les forêts et d’augmenter le carbone organique du sol. Selon l’analyse du cycle de vie de la FAFU, le potentiel de fixation du carbone varie entre 6,7 et 67,5 tonnes par hectare annuellement lorsque l’herbe Juncao remplace les produits ligneux.
Important également : les évaluations de biosécurité, réalisées par des chercheurs dans la province du Fujian, confirment que les herbes Juncao ne constituent pas une menace invasive et ne requièrent donc pas de mesures préventives spécifiques. Sans graines et se reproduisant de façon asexuée, ces herbes sont contrôlables en termes de dissémination et s’adaptent bien à diverses zones agro‑écologiques sans déplacer la flore indigène (Lu et al., 2014).
Partenariats mondiaux et coopération Sud‑Sud
L’expansion de la technologie Juncao illustre le potentiel de la coopération Sud‑Sud. La Chine a mis en œuvre des projets de démonstration dans plus de 30 pays, dont la Papouasie‑Nouvelle‑Guinée, Madagascar, la République centrafricaine, les Fidji, l’Ouganda, le Brésil et les Îles Salomon. Ces programmes s’alignent de manière importante sur les objectifs de nombreux ODD, car ils offrent des solutions prometteuses pour lutter contre la pauvreté (1), la faim (2), et combattre le changement climatique (13) via des partenariats (17). Parallèlement, des forums régionaux organisés par l’UNDESA et la Mission de la Chine auprès de l’Union africaine ont mis l’accent sur le transfert technologique inclusif adapté aux conditions locales. Par exemple, le « Deuxième atelier régional sur les applications de la technologie Juncao », tenu en 2023 à Addis‑Abeba, a rassemblé des représentants de nombreux gouvernements africains, de la société civile et d’institutions de recherche. Ce forum a mis en lumière les réalisations des projets pilotes en cours et exploré l’intégration du Juncao dans les plans de développement nationaux.
Défis et considérations
Malgré ses succès, le déploiement du Juncao nécessite une navigation prudente des lacunes de capacité locale, des défis de gouvernance, et des sensibilités géopolitiques plus larges. Une infrastructure technique limitée, le manque de connaissances en production de spawn, et une cohérence politique faible peuvent compromettre la durabilité. Certains soutiennent que, bien que l’aide agricole de la Chine offre des technologies intermédiaires adaptées aux conditions rurales, elle ne remet pas fondamentalement en cause les paradigmes de développement néolibéraux. Par exemple, au Rwanda et en Ouganda, les ATDC ont été considérés comme efficaces pour autonomiser les agriculteurs de taille moyenne et les entrepreneurs, mais moins impactant pour les ménages de subsistance (Lawther, 2017). De plus, il existe des préoccupations légitimes concernant la transparence des projets et la responsabilité. Lin et Cui (2024) indiquent que les entreprises publiques mettant en œuvre les ATDC étaient plus efficaces que les contractants privés en raison de meilleures normes de gouvernance. Cependant, la phase de coentreprise, destinée à commercialiser les centres de démonstration après le financement initial chinois, peut souvent conduire à la monopolisation et à la rétention des savoirs, comme observé dans la production de spawn de champignons au Rwanda.
Enfin, la géopolitique impacte inévitablement les perceptions occidentales et celles des pays bénéficiaires vis‑à‑vis des initiatives Juncao. Comme le souligne l’analyse de Denghua Zhang (2023), la concurrence croissante entre la Chine et les bailleurs traditionnels dans le Pacifique a entraîné des recalibrages stratégiques dans la prestation de l’aide. Bien que la Chine présente ostensiblement les partenariats Sud‑Sud comme une promotion, un scepticisme persiste parmi les décideurs dans les pays bénéficiaires quant à ses intentions à long terme.
Conclusion : une adoption prudente
La technologie Juncao offre un modèle convaincant pour une agriculture durable, la restauration écologique, et un développement inclusif. Sa polyvalence — englobant l’agriculture, l’alimentation, l’énergie et l’écologie — lui permet de contribuer de façon significative à de nombreuses priorités de développement. Son usage en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans le Pacifique met en lumière sa scalabilité et son adaptabilité. Pourtant, une mise en œuvre efficace dépend non seulement de la technologie elle‑même mais aussi de l’architecture sociale qui l’entoure. Formation, gouvernance, appropriation locale, et conscience géopolitique doivent compléter l’innovation agronomique. À mesure que les pays poursuivent des transitions vertes et la résilience de leurs systèmes alimentaires, le Juncao offre à la fois une boîte à outils pratique et une voie symbolique : celle qui rassemble la gérance de l’environnement et l’autonomie économique.
Les leçons tirées des pays ayant adopté la technologie Juncao ne sont pas de simples études de cas techniques — elles sont la preuve que l’échange de connaissances, la coopération Sud‑Sud et une science inclusive peuvent produire des bénéfices tangibles. Il ne s’agit pas simplement de transplanter la technologie, mais de co‑créer des futurs durables ancrés dans des valeurs partagées, des stratégies localisées, et un renforcement depuis la base — jeu de mots pardonné !
Avec le soutien continu des gouvernements, des agences de l’ONU, des institutions de recherche, et des coopératives agricoles, le plein potentiel du Juncao pour stimuler une agriculture résiliente au climat et transformer les moyens de subsistance peut être réalisé. L’herbe Juncao n’est pas une solution miracle — mais elle pourrait potentiellement être un levier vert. Le Sud global ne doit pas simplement adopter la technologie Juncao — il doit l’adapter et s’en approprier. Ce n’est qu’à cette condition que cette « herbe magique » pourra croître non seulement des champignons, mais aussi l’autonomie.
Références
Fujian Agriculture and Forestry University (FAFU), 20ᵉ conférence internationale sur le développement de l’industrie Juncao (2024) – https://english.fafu.edu.cn/38/f0/c13172a407792/page.htm
Krishneel, Kavish et Jovilisi Tabuyaqona, « Juncao Grass and its Application as Livestock Feed », au Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UNDESA), Atelier international sur les applications de la technologie Juncao et sa contribution à l’éradication de la pauvreté, à la promotion de l’emploi et à la protection de l’environnement (2024) – https://sdgs.un.org/sites/default/files/2024-03/6.%20Presentation%20by%20Mr.%20Kavish%20Krishneel%20%26%20Mr.%20Jovilisi%20Tabuyaqona.pdf
Lawther, Isaac, « Why African countries are interested in building agricultural partnerships with China », Third World Quarterly, 38(10) (2017), 2312‑2329
Lin, Dongmei, The Latest Research Progress and Application of Juncao Technology and Sustainable Development, au Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UNDESA), Atelier international sur les applications de la technologie Juncao et sa contribution à l’éradication de la pauvreté, à la promotion de l’emploi et à la protection de l’environnement (2024) – https://sdgs.un.org/sites/default/files/2024-03/5.%20Presentation%20by%20Dr.%20Dongmei%20Lin_0.pdf
Lin, Shen et Cui, Jingbo, « South‑South cooperation and food security: Evidence from Chinese agricultural technology demonstration Centre in Africa », China Economic Quarterly Journal, 4(1) (2024), 1‑12
Lu, Peng, Yi‑Fan Yang, You‑Ming Hou et Guo‑Dong Lu, « The Biosafety Assessment of Introduced Pennisetum sp. In Fujian Province China », Fujian Journal of Agricultural Sciences, 29(11) (2014), 1132‑1137
United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), Atelier international sur les applications de la technologie Juncao et sa contribution à l’éradication de la pauvreté, à la promotion de l’emploi et à la protection de l’environnement (2024) – https://sdgs.un.org/events/international-workshop-applications-juncao-technology-and-its-contribution-alleviating
United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), Deuxième atelier régional sur les « Applications de la technologie Juncao et sa contribution à la réalisation de l’agriculture durable et des Objectifs de développement durable en Afrique » 18‑19 décembre 2023 (2023) – https://sdgs.un.org/events/second-regional-workshop-applications-juncao-technology-and-its-contribution-achievement
PAM China Centre of Excellence, étude de cas des Fidji : ensilage Juncao et alimentation animale (2023) – http://www.wfpchinacoe.net/2023-03/21/content_85182454.shtml
Zhang, Denghua, « Beijing Reshapes its Pacific Strategy », dans Linda Jaivin, Esther Sunkyung Klein et Annie Luman Ren (dirs.), Chains, (2023), 255‑261



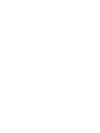
Laisser un commentaire