
L’impact de l’exploitation du zircon au Sénégal : le cas des opérations de Grandes Côtes
En 2014, après trois ans de planification et de construction, la société minière Grande Côte Opérations, également connue sous le nom de GCO, était enfin prête à lancer son nouveau projet : l’extraction de zircon sur la côte nord-ouest du Sénégal. Ce projet s’accompagnait de nombreux sacrifices et compromis jugés nécessaires, mais aussi de promesses d’indemnisation et de revenus pour les populations locales. Dix ans plus tard, la population locale se sent trahie, l’environnement est détruit et la population perd l’espoir d’une juste compensation.
Pour mieux comprendre la situation et ses implications, il est important de revenir sur le projet initial avant d’aborder ses conséquences. Le zircon, également appelé zirconium, est utilisé dans divers domaines pour sa capacité à résister à des températures extrêmement élevées et sa résistance globale. Il peut être utilisé dans la céramique, mais son utilisation principale se situe dans des industries à plus forts enjeux, comme la médecine ou l’énergie nucléaire, ce qui explique la forte demande pour ce produit (AIEA, 2023). Le Sénégal est considéré comme possédant le troisième plus grand gisement de zircon au monde, ce qui en fait une terre d’exploitation convoitée. Si le Sénégal dispose d’importantes quantités de zircon, celles-ci ne sont pas centralisées, mais plutôt dispersées sur le littoral, mélangées à du sable (Jeune Afrique, 2014). C’est pourquoi GCO, détenue à 90 % par l’entreprise française Eramet, les 10 % restants appartenant à l’État sénégalais, a entrepris en 2011 la construction d’une usine mobile capable d’extraire du zircon et d’autres minéraux du sable. Durant les trois années de construction, l’entreprise a planifié le tracé de l’usine de traitement, en accord avec le gouvernement, sans se soucier des impacts sur la zone initialement occupée. Dans ce plan, GCO a promis une indemnisation à toutes les personnes dont les conditions de vie seraient affectées par ce projet, et a justifié ce dernier par la promesse d’une croissance économique pour le pays et d’une redistribution d’une partie des bénéfices. Après dix ans, quel est le bilan ?
Exploitation du zircon au Sénégal : dix ans de développement : où en sommes-nous ?
Une première préoccupation concernant ce projet concerne ses bénéficiaires. Eramet et les autorités sénégalaises affirment tous deux que GCO et son projet minier sont bénéfiques pour l’économie sénégalaise, stimulant ses exportations, employant des locaux et améliorant globalement leur situation (Eramet). Or, si l’on examine la situation, on constate qu’une entreprise majoritairement française exploite les ressources du Sénégal aux dépens de la population locale et les vend principalement aux pays développés occidentaux, l’Italie et l’Espagne étant les principaux consommateurs de zircon sénégalais (Observatoire de la complexité économique, 2023). Vu sous cet angle, le projet paraît radicalement différent et enracine davantage le Sénégal dans une relation néocoloniale avec les pays développés. Cela rejoint la théorie des systèmes-mondes de Wallerstein, selon laquelle le centre, en l’occurrence l’Europe, entretient une relation de dépendance avec sa périphérie, le Sénégal, ne lui permettant jamais d’être pleinement indépendant et autonome. Le centre limite le développement de la périphérie, tout en bénéficiant de sa main-d’œuvre et de ses ressources bon marché (Wallerstein, 1992). Si les exportations de zircon sont certes bénéfiques pour l’économie sénégalaise, la prise de contrôle de GCO par Eramet pose un problème pour le développement du pays. Mais au-delà de cette vision d’ensemble, quelles sont les implications de ce projet sur les populations locales et leur environnement ?
Conséquences sociales…
Depuis sa création, l’usine a parcouru plus de 100 kilomètres le long du littoral nord-ouest du Sénégal. Chaque jour, depuis dix ans, elle avance de 30 mètres sans interruption, ratissant le sable et le triant afin de trouver du zircon, mais aussi d’autres matériaux comme l’ilménite (Eramet). Comme indiqué précédemment, l’itinéraire a été défini entre 2011 et 2013, privilégiant les aspects économiques et les revenus. Cela signifie que tout obstacle considéré comme tel a été supprimé sans que l’autre partie n’ait à le décider. Certains villages, comme Fott, ont été entièrement déplacés par GCO afin de préserver l’itinéraire initial de l’usine mobile. GCO a déclaré : « Le volet relocalisation et communauté représente 14 % de nos dépenses actuelles, ce qui en fait la troisième dépense la plus importante après l’énergie et les salaires. » (Le Monde, 2023) afin de démontrer son souci des populations locales et l’idée que ce projet leur profite en premier lieu. En réalité, les villageois se sont tous vu proposer une relocalisation et un logement, mais de qualité médiocre : maisons trop petites pour accueillir les familles, terres infertiles les empêchant de cultiver, isolement géographique et accès limité à l’eau. La plupart de ces familles ont perdu leur principale source de revenus lors du déplacement, mais n’ont d’autre choix que d’accepter en raison de leur situation financière (TV5 Monde). Dix ans plus tard, la situation n’a pas changé et les populations locales ont commencé à s’exprimer. Différentes manifestations ont eu lieu contre le projet, mais principalement contre le traitement qui leur a été réservé. Outre la faible indemnisation et la relocalisation, les villageois de Fott accusaient GCO d’avoir divisé les familles pendant le déplacement et d’avoir manqué de respect à leurs terres et à leurs ancêtres. L’extraction du zircon et des autres minéraux commence par l’inondation des terres exploitées, ce qui détruit des terres et des lieux sacrés, notamment des cimetières (TV5 Monde). GCO, par la dislocation des villages, a contribué à la destruction culturelle, au manque de revenus économiques et à l’isolement de nombreux habitants de la région de Tivaouane, mais continue de nier toutes les accusations.
… d’un plan aux conséquences environnementales désastreuses
Une autre conséquence évidente du projet est la destruction de l’environnement, déjà terrible en soi, mais qui entraîne également une baisse de l’activité économique dans divers secteurs, pour la population locale (Le Monde, 2023). Avant l’arrivée de l’usine mobile, des arbres sont abattus en prévision de son arrivée, détruisant ainsi l’écosystème local. S’ensuivent les inondations et le tri du sable. Une fois l’usine de transformation passée, il ne reste que des terres arides et infertiles. De nombreux agriculteurs locaux se sont vu confisquer leurs terres en échange d’indemnisations, parfois inférieures au revenu d’une année de récolte, et ont reçu des terres sans sol sur lesquelles ils ne peuvent rien cultiver les années suivantes (TV5 Monde). La destruction de l’écosystème et la dégradation de la fertilité des terres ne sont pas les seuls impacts environnementaux du projet GCO : l’entreprise perturbe également les systèmes d’irrigation et l’accès à l’eau dans la région, affectant à nouveau la population locale souffrant de l’assèchement des puits, mais surtout les agriculteurs de la région. Les conséquences sont plus vastes, car 80 % des légumes du Sénégal sont produits dans la région. Finalement, la décision qui a suscité le plus de réactions au sein de la population sénégalaise a été l’implantation de l’usine mobile dans le désert de Lompoul. Ce site naturel sénégalais faisait vivre sa région grâce au tourisme, mais en 2023, GCO a inondé une partie de ce désert pour poursuivre le projet minier. Non seulement cela a détruit l’écosystème, mais cela a également ruiné l’économie du désert de Lompoul. Plusieurs entreprises ont dû fermer, et certaines ont reçu des compensations financières bien inférieures à leurs pertes financières. La plupart n’ont pas été indemnisées, car elles se trouvent à proximité du désert et non à l’intérieur. Et celles qui n’ont pas fermé ont vu leur activité fortement diminuer, les touristes se raréfiant dans la région depuis l’arrivée du projet.
GCO a reconnu les conséquences environnementales négatives du projet et a lancé une campagne de réhabilitation des zones sinistrées. Des arbres sont plantés et les sols sont remis en terre pour les rendre à nouveau fertiles. GCO s’efforce constamment de démontrer son engagement et son souci de l’environnement et des populations locales, que ce soit par sa volonté de revitaliser l’écosystème après la fermeture de l’usine, par l’important budget de relocalisation, par ses 2 000 employés locaux ou par sa déclaration selon laquelle 120 millions d’euros seront reversés au Sénégal (Eramet). Bien sûr, ces mesures sont positives, mais elles sont loin d’être suffisantes. Leur politique de réhabilitation environnementale est bonne et semble efficace, mais elle ne tient pas compte des nombreuses années de terres arides et infertiles. Il en va de même pour leurs tentatives de relocalisation et d’indemnisation financière. Alors que GCO se vante de son travail pour la population locale, le strict minimum n’est même pas respecté. La plupart des indemnisations étaient injustes et abusives, et comme indiqué précédemment, la relocalisation a eu des conséquences désastreuses pour les villageois, qui n’ont pas encore constaté les effets supposément positifs de ce projet au Sénégal.
De nouvelles mesures pourraient être mises en place au bénéfice des populations et de l’entreprise. Par exemple, l’État sénégalais devrait s’efforcer de conclure un contrat plus équitable avec Eramet, avec des parts égales de Grandes Côtes Operations pour chacun des deux groupes, plutôt que la situation actuelle de 90/10. Pour éviter toute indemnisation injuste, les populations locales devraient en discuter avec GCO, plutôt que l’entreprise agisse seule, avec la garantie de l’État sénégalais. Enfin, pour garantir que le projet bénéficie aux populations locales et à l’État sénégalais, comme annoncé, une partie des revenus de GCO pourrait être directement reversée aux infrastructures publiques sénégalaises, comme les hôpitaux et les routes. Ainsi, nous serions assurés d’une redistribution au bénéfice de la population.
En conclusion, l’exploitation du zircon au Sénégal renforce encore la relation centre-périphérie entre le Sénégal et l’Europe, et globalement, sacrifie temporairement les populations locales et l’environnement au profit de l’économie du pays. Les retombées économiques du projet sont conséquentes pour le pays, mais elles ne justifient pas nécessairement les coûts. GCO s’efforce clairement de faire mieux, mais la marge de progression est encore importante, et la population sénégalaise continuera de s’efforcer de le faire comprendre. Mais Grandes Côtes Operations n’est pas un cas isolé : de nombreuses entreprises internationales convoitent une part du zircon sénégalais, laissant la population au second plan.
Références :
Ba, M.B., Diouf, P.S. et Sakho, O. (10 juillet 2025). [Enquête] Exploitation du zircon de Diogo : Dans la misère des populations déplacées. Seneweb.com. https://www.seneweb.com/news/Video/exploitation-du-zircon-de-diogo-dans-la-_n_362474.html
Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l’homme. (2021). Sénégal : Une enquête soutient que GCO n’a pas tenu ses engagements envers les populations relogées qui vivent dans la misère ; l’entreprise répond en rejetant toutes les allégations – Business & Human Rights Resource Centre. Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l’homme. https://www.business-humanrights.org/fr/latest-news/s%C3%A9n%C3%A9gal-une-enqu%C3%AAte-soutient-que-gco-na-pas-tenu-ses-engagements- envers-les-populations-relog%C3%A9es-qui-vivent-dans-la-mis%C3%A8re-lentreprise-r%C3%A9pond-en-rejetant-toutes-les-all%C3%A9gations/
Dialo, AO (2021). Sénégal : Grande Côte Opérations, un minier en pleine expansion. JeuneAfrique.com. https://www.jeuneafrique.com/1353826/economie-entreprises/senegal-grande-cote-operations-un-minier-en-pleine-expansion/
Éramet. (27 octobre 2024). Production de sables minéralisés – Eramet Grande Côte. Eramet Grande Côte. https://gco.eramet.com/eramet-grande-cote/our-value-chain/mineral-sands-production/
Jeune Afrique. (2025). Sénégal : la production de zircon commence dans les temps. JeuneAfrique.com. https://www.jeuneafrique.com/11335/economie-entreprises/s-n-gal-la-production-de-zircon-commence-dans-les-temps/
Ollivier, T. (9 août 2023). Au Sénégal, la rue vers le zircon menace le désert de Lompoul. Le Monde.fr ; Le Monde. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/08/09/au-senegal-la-ruee-vers-le-zircon-menace-le-desert-de-lompoul_6184948_3212.html
Ouestaf. (27 août 2015). Bataille à mort autour d’un minéral précieux : le zircon. Courrier International ; Courrier International. https://www.courrierinternational.com/article/senegal-bataille-mort-autour-dun-minerai-precieux-le-zircon
Pieri, A.-S. (10 avril 2025). Tout savoir sur le zircon, ce minéral stratégique notamment exploité dans le nord du Sénégal. TV5MONDE – Informations. https://information.tv5monde.com/afrique/tout-savoir-sur-le-zircon-ce-minerai-strategique-notamment-exploite-dans-le-nord-du-senegal
Sénégal Export. (29 mai 2019). Sénégal : augmentation des recettes d’exportation de zircon – Le Sénégal à l’export. Le Sénégal à l’export ; Le Sénégal à l’export. https://www.senegal-export.com/actualites/senegal-augmentation-des-recettes.html
Vlasov, A. (1er février 2023). Cinq faits intéressants à savoir sur le zirconium. www.iaea.org. https://www.iaea.org/newscenter/news/five-interesting-facts-to-know-about-zirconium
Wallerstein, Immanuel. « L’Occident, le capitalisme et le système-monde moderne ». Revue (Centre Fernand Braudel) 15, n° 4 (1992) : 561–619. http://www.jstor.org/stable/40241239.




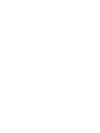
Laisser un commentaire